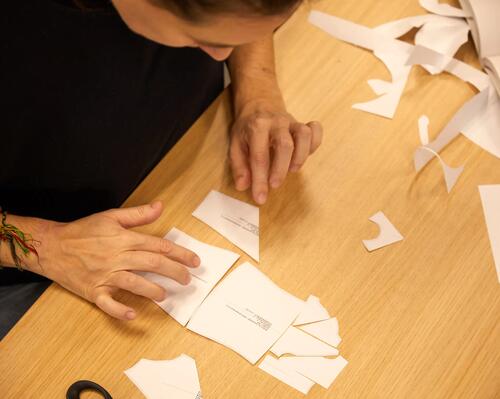Concrètement, comment ça marche ?
DECATHLON travaille avec des collecteurs / trieurs (des organismes qui se chargent de la collecte et du tri par couleur, matière, etc.).
Nous achetons ces matières premières pour ensuite les envoyer à des recycleurs. Ce sont eux qui vont faire de ce stock de vêtements usagés, de nouvelles fibres de coton. Aujourd’hui, nous favorisons le recyclage mécanique (le tissu est déchiqueté, effiloché et ne subit pas de traitement chimique, comme dans un process de filature “classique” finalement) pour le recyclage de ces fibres.
L’autre avantage, c’est que cette technique ne dénature pas la fibre : elle garde les vertus du coton vierge (comme le toucher ou l’aspect).
L’inconvénient, parce qu’il faut bien admettre qu’il pourrait en avoir, c’est que la question de la qualité doit se poser différemment. Avec cette technique, les fibres sont un peu plus courtes, ce qui baisse la qualité (une baisse qui se traduit par moins de résistance ou des risques de boulochage). Pour parer ce risque, il faut alors procéder à un équilibre coton recyclé / coton vierge. On retrouve cette balance de 30% (recyclé) / 70% (vierge), pour maintenir un bon niveau de qualité.
(nb : On pourra envisager, au moment de la fin de vie de ce “produit mélangé”, une autre boucle de recyclage. Cela dit, oui, mécaniquement, chaque recyclage potentiel viendra réduire la longueur de la fibre et, donc, la qualité).
L’autre point, c’est celui des contaminations. Oui, ça peut faire un peu peur, mais ce mot traduit ici une réalité toute simple, et pas très effrayante : en utilisant des tissus issus de collectes, on retrouve parfois des petites irrégularités : un fil jaune clair qui aurait pu se glisser dans les lots de tissus blancs, par exemple. La qualité et la résistance des nouvelles fibres ne seraient évidemment pas remises en cause, mais certain•es pourraient l’assimiler à un défaut visuel. Alors que c’est ce qui fait que t-shirt (par exemple) est unique et porte encore en lui une petite part de ses anciennes vies, faites, cette fois de petits périples ! Car ici, pas question de tour du monde en avion : la collecte se fait en Europe, le fil est travaillé en Espagne ou au Portugal, le tricotage, les finitions et la confection en Égypte et la zone d’approvisionnement, le marché restent dans cette zone (pour le moment, en 2023, ce process est interdit en Chine et l’Inde travaille aussi en local to local).
Enfin, l’autre challenge de ce nouveau process se trouve du côté de la loi : comment renseigner directement les étiquettes de composition si on ne connait pas précisément d’où viennent les vêtements recyclés ? Comment gérer les éventuels risques chimiques ? Les traces persistantes de produits auparavant autorisés… mais qui ne le sont plus aujourd’hui ? Des questions sur lesquelles travaillent les industriels.