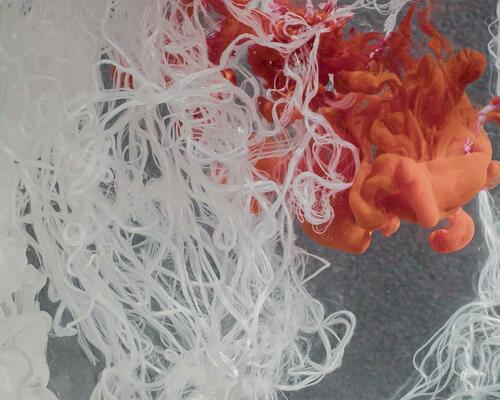La réparabilité : un système où tout le monde est gagnant
Se (re)mettre à réparer les objets qui peuplent notre quotidien n’a que des avantages.
La réparation permet évidemment d’économiser de l'argent. Au lieu de racheter un produit neuf, le consommateur ou la consommatrice réinvestit une somme moindre pour obtenir, in fine, un service identique (l’utilisation du produit). Simple et efficace !
Le fait de réparer un produit est également notable côté environnement.: un objet réparé, c’est un objet de moins à produire, CQFD. Et des déchets en moins à traiter. Soit autant d’électricité, d’eau, de carburant et de matières premières épargnées… De quoi réduire nettement son empreinte écologique.
Pour le producteur, la réparabilité a aussi des vertus : en plus d’atténuer sa propre empreinte écologique, elle lui permet d’éviter des coûts... évitables, comme ceux générés par le remplacement des produits en panne ou cassés. Il est plus pertinent économiquement de remplacer le zip défectueux d’un sac plutôt que le sac tout entier.
On peut ajouter, pour la communauté, que les pratiques de réparation font émerger et/ou renforcent les liens sociaux. Fablabs, repair cafés, ateliers de réparation en magasin… les lieux dédiés se multiplient en France, offrant autant d’occasions de se rencontrer, de partager des savoir-faire et des solutions collaboratives.
Pour l’économie, enfin, la réparabilité permet la création de filières locales et d’emplois non délocalisables. Car réparer son vélo ou le zip de son sac, ça reste plus simple au coin de la rue qu’à l’autre bout du monde…
Avec la réparabilité, on s’inscrit dans une logique vertueuse et sobre, celle de l’économie circulaire. Ou comment sortir du schéma linéaire produire > consommer > jeter pour revenir à des dynamiques économes en ressources et matières premières : produire > utiliser > réparer (ou recycler) > réutiliser.